La Mémoire du Vautour de Fabrice Colin - 5 - L’expérience intérieure (27/08/2007)
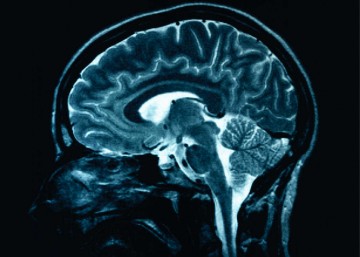
« With your feet in the air and your head on the ground
Try this trick and spin it, yeah
Your head will collapse
If there's nothing in it
And you'll ask yourself »
Pixies, Where is my mind
Récapitulons. La Mémoire du vautour, disions-nous, se situerait donc à l’extrême lisière de la mort, non à la jonction impossible de l’en-deça et de l’au-delà, mais à la tangente de l’avant et du pendant. Au moment de sa mort, Tyron se serait replié dans les espaces infinis de son esprit et de sa mémoire. Pourquoi sommes-nous certains que La Mémoire du vautour ne recèle aucun au-delà ? Concrètement, Fabrice Colin ne dit rien de l’après[1] (la relation d’événements ultérieurs à la mort de Tyron, les liens paradoxaux entre les personnages, seront abordés plus tard) : les narrations de Sarah, Reeltoy, Narathan et Io-Tancrède sont enchâssées dans celle de Tyron, qui elle-même, d’un point de vue objectif, ne devrait s’étaler que sur une fraction de seconde infinitésimale. Et par ailleurs, pour Alan Watts, ombre tutélaire du roman, il n’y a rien après la mort. S’agit-il alors seulement d’un exercice de style, qui consisterait à étirer démesurément le temps de la narration, comme le fit, par exemple, James Joyce dans Ulysse ?... Ou bien d’une simple construction en flash-back ?... Certes non. Une histoire de fantôme alors ? Un passage de la fin du roman pourrait le laisser penser : « Prenez un fantôme. Prenez un homme qui a quitté la vie et qui ne le sait pas. Prenez une voiture renversée et en flammes, gisant au milieu du Golden Gate Bridge. Voyez l’ambulance. Voyez le brancard, et la couverture relevée, reflets de métal, voyez les hochements de tête désolés et les taches de sang sur l’asphalte. Ecoutez les sirènes. L’œuvre peut naître. La matière : un fantôme. Le thème ? » (293-294). Et cependant, le fantôme a valeur de métaphore. Le fantôme : c’est-à-dire le personnage censé être mort mais qui refuse de quitter le monde des vivants. La fantôme : la trace, l’empreinte d’une vie, métaphore de ce qui subsiste de nous après notre mort. Vu de l’extérieur, Tyron est mort, mais le roman est vécu de l’intérieur. C’est le fantôme qui parle – et l’on pourrait, si l’on n’y regarde pas de trop près, prendre le roman au pied de la lettre : un homme, Tyron, meurt, et comme, selon Alan Watts, « ce n’est pas la conscience qui meurt, mais la mémoire », Tyron se dépêtre dans une mémoire morcelée, mourante, qui s’efface à mesure qu’il s’enfonce dans la mort. Mais cela ne fonctionne pas. D’une part, comme nous l’avons vu, on ne « s’enfonce » pas dans la mort : on est vivant, on est conscient, et l’instant d’après, on ne l’est plus – surtout quant il s’agit d’un accident fulgurant avec mort instantanée, comme dans le cas de Tyron. Et d’autre part, cela ne résout rien. Tyron serait un fantôme ? Alors tous les autres personnages sont aussi des fantômes, et toute la réflexion du roman sur la mort devient absurde. Ils sont des fantômes, dans une certaine mesure, mais ils nous parlent moins de la vie après la mort, que de la queue de la comète (que laissons-nous derrière nous ? comment avons-nous transformé le monde ?). Quoi qu’en disent les personnages, nous ne sommes jamais dans l’au-delà, mais dans un cerveau. Ni eschatologique, ni explicitement surnaturel, La Mémoire du vautour est l’étrange exploration d’espaces, ou paysages, intérieurs, comme en atteste l’usage quasi systématique de la première personne. Reste à comprendre comment se dessine cette carte imaginaire.
La Mémoire du vautour, qui revendique implicitement sa qualité d’expérience, à vivre plutôt qu’à analyser (Watts : « Le mystère de la vie n’est pas un problème à résoudre, mais une réalité à éprouver. »), s’articule en effet dans sa quasi-totalité au cœur d’un être à l’ipséité[2] vacillante, celle d’un personnage-mystère qui, incarné en Tyron, vit la tangente de sa mort comme une crise schizophrénique, comme une singularité absolue dont nous verrons plus loin qu’elle ne saurait être réduite à une fuite solipsiste. Cette singularité est d’ailleurs métaphorisée dans le roman, sous la forme d’une salle de bains dont les dimensions augmentent de jour en jour jusqu’à atteindre des proportions effrayantes, infinies. « Lorsque j’ai acheté cet appartement, la salle de bain n’était pas aussi vaste. Au fil du temps, ses dimensions se sont curieusement élargies. […] C’est ici que je passe l’essentiel de mon temps libre, adossé à l’appui-tête, les pieds perdus dans les remous. Un lieu hors du monde » (20). Outre qu’elle évoque d’autres lieux du même type dans la littérature fantastique (Ballard, Lovecraft, Danielewski…), cette pièce « hors du monde »[3] (hors du monde réel en effet, puisque Bill est soit mort, soit en train de mourir) renvoie surtout – si l’on met de côté, momentanément, l’évidente métaphore utérine – aux paradoxes de Borges. Comme la fiction borgésienne, la salle de bain paradoxale ouvre de nouvelles perspectives, infinies et cependant sans topographie réelle, purement imaginaires. « Ma salle de bain a encore grandi. Je répugne à m’aventurer plus loin que le lavabo. Je n’ai pas installé de lumière dans le coin ; il fait noir, le sol est froid, dur comme de la glace. Lorsque j’avance mon bras, lorsque j’agite mes doigts, je ne vois plus rien, et l’écho de mes pulsations cardiaques tend à s’atténuer. » (45) Elle représente à la fois le non-lieu de la mort, où l’être s’anéantit totalement, et le territoire infini de la mort-qui-survient, singularité semblable à la bulle d’espace-temps des Enfants Bleus de Temps de Stephen Baxter.
Dans le chapitre « La mort est en un sens une imposture » de L’expérience intérieure, Georges Bataille écrit que dans le chaos hors du monde de ce qu’il qualifie de « catastrophe » (la mort), le temps est « annulé », « sorti de ses gonds ». Avant de conclure : « La mort me délivrant d’un monde qui me tue enferme en effet ce monde réel dans l’irréalité d’un moi = qui = meurt. »[4] Et pour Jankélévitch, « [à] la pointe aiguë de l’instant mortel, toute distance spatiale et tout éloignement temporel s’annulent. […] »[5]. Le monde réel, enfermé dans l’irréalité d’un moi-qui-meurt… Tandis que pour l’extérieur, le mourant disparaît, effacé de sa réalité présente, pour le mourant c’est le monde réel qui disparaît, subrogé par son double mental. Le monde arpenté par Bill Tyron et les autres narrateurs de La Mémoire du vautour n’est certes pas le monde réel, mais le monde réel déformé par la mémoire, par l’inconscient, et par autre chose, une transcendance que nous évoquerons plus loin, et qui a quelque chose à voir avec le « Je » qui, rappelez-vous, se cache dans l’ombre des personnages.
La « tangente » évoquée par Jankélévitch, se manifeste dans le roman par une certaine forme d’immortalité, avons-nous dit, mais qui aurait quelque chose à voir avec la damnation (Medan, la ville indonésienne, théâtre de divers événements dans le roman, n’est pas seulement l’homonyme de la résidence d’Émile Zola : c’est aussi l’anagramme de « damné »…), où passé, présent, futur, se confondent sans cesse, s’interpénètrent, se subvertissent sans fin, plutôt qu’avec une éternité de béatitude : « Je pense : notre mémoire rend le passé moins réel, mais aucune hiérarchie ne prédomine. Demain, hier, c’est la même chose : de l’information. » (21). « Je ne pense jamais à avant, à cette saloperie d’accident. Je suis les conseils du sage. Le vent est ma respiration, mes pensées les nuages. Il est incroyable de vivre, disait Watts. Mais plus incroyable encore de penser que ce qui s’est produit une fois ne puisse pas se reproduire. » (21) : « avant » : les italiques sont-elles une marque d’insistance ou de doute ? La réponse est dans la dernière phrase : l’accident s’est effectivement produit (au Golden Gate Bridge, lieu-clé du Vertigo d’Hitchcock auquel faisait déjà référence Or not to be), ou est en train de se produire, mais, dans le roman, ne sera décrit qu’après… Il n’y a plus de hiérarchie temporelle, les personnages n’ont plus une perception parfaitement linéaire et causale du temps (il nous faut alors nous demander – et nous n’y manquerons pas – qui ordonne, malgré tout, le récit…). Les fragments ne forment plus un dessin originaire qu’il s’agirait de reconstituer en reliant les points entre eux, mais un dessin original qu’il s’agit d’interpréter. Chaque narrateur nous aspire dans son cosmos local – son enfer. Mais s’il y a damnation, c’est une damnation sans dieu, et sans diable, une damnation mentale, d’ordre psychotique, que nous étudierons dans la sixième partie, « Temps, récit et schizophrénie »…
À suivre.
Rappel :
La Mémoire du vautour – 1 – Introduction
La Mémoire du vautour – 2 – Résumé
La Mémoire du vautour – 3 – La mort impensable
La Mémoire du vautour – 4 – JE est un autre
À lire aussi :
Entretien avec Fabrice Colin (juin 2006)
[2] IPSÉITÉ : pouvoir d'un sujet pensant de se représenter lui-même comme demeurant le même malgré tous les changements physiques et psychologiques qui peuvent advenir à sa personne au cours de son existence.
[3] Un lieu hors du monde… Maurice Merleau-Ponty qualifiait en ces termes l’Ego transcendantal, ce lieu où le philosophe empiriste « se plaçait tacitement pour décrire l'événement de la perception », étant entendu que le champ perceptif échappe à la description des faits qui se produisent dans le monde. Cf. M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, « Tel » (1945), 1976, pp. 240-241.
[4] G. Bataille, L’expérience intérieure, Paris, Gallimard, « Tel » (1943 et 1954 pour le texte revu et corrigé), 2001, p. 90.
[5] V. Jankélévitch, op. cit., p. 33.
14:11 | Lien permanent | Commentaires (60) | Tags : Littérature, critique littéraire, science-fiction, Fabrice Colin, La mémoire du vautour, mort, fantôme |  |
| ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
Commentaires
Je m'oblige toujours à ne pas te lire tant que je n'aurai pas conçu mon article, de mon côté...
En revanche, si Fabrice pouvait avoir l'obligeance, l'amabilité, l'extrême gentillesse de signifier à Transhumain qu'il a au moins lu cette série de textes, je crois que ce serait salvateur pour la santé mentale de mon ami le dangereux transhumaniste. Juste histoire de lui signifier que le monde extérieur existe encore, même après avoir lu La mémoire du vautour. Que nous sommes bien vivants. Que la rentrée littéraire a lieu, qu'il y a le Danielewski, le Vollmann, le DeLillo, le Volodine, à lire, pour ne pas désespérer.
(non, on ne dira pas ici ce qu'on a pensé du Dantec...)
Écrit par : Bruno | 27/08/2007
On ne le dira pas mais on n'en pensera pas moins... Merci pour ma santé mentale, mais elle se porte bien ! Fabrice n'a pas besoin de se manifester, je sais qu'il me lit.
Écrit par : Transhumain | 27/08/2007
Précisément, je ne suis pas encore télépathe.
Vous ne le direz pas. Mais de quoi avez-vous peur ?
Écrit par : Samuel | 27/08/2007
Tss, c'est marrant. J'écris "Dantec" et hop, ça fait surgir Samuel.
Le dernier Dantec, j'en parlerai peut-être sur Systar, je ne sais pas.
Rien que pour le plaisir de voir me tomber dessus les anti et les pro Dantec... Vous avez aimé, Samuel?
Non, je n'ai peur de personne, ni de rien, et Olivier de même.
Mais là on préfèrera causer de Fabrice Colin, qui vend moins, fait moins de bordel médiatique à chacun de ses livres, mais écrit des choses aussi belles et intellectuellement exigeantes que Dantec quand il est "en forme".
Olivier: non, ta santé mentale est en péril, je le sais. Je t'ai vu, la mine décomposée, bosser ton Colin par de pleins soleils d'été, ne trouvant plus goût à la promenade, préférant relire Io-Tancrède et spéculer sur Sarah...
"Fabrice: je sais qu'il me lit": tu vois que ça ne va pas bien! Tu sens des présences occultes autour de toi, tu sens qu'on t'espionne, qu'on inspecte ton travail, tes faits et gestes...
Écrit par : Bruno | 27/08/2007
Samuel : première raison pour n'en point parler ici : je ne l'ai pas encore lu (seulement de nombreux passages pris au hasard, qui m'inquiètent beaucoup - procédés usés jusqu'à la corde, thèmes déjà explorés cent fois, complaisance du Monde de ce Prince, etc. -, et les réactions de quelques lecteurs avisés, qui m'inquiètent tout autant), deuxième raison pour n'en point parler ici : comme le dit Bruno, ici on parle de Fabrice Colin. Artefact, ce sera pour plus tard.
Écrit par : Transhumain | 28/08/2007
Excellentes raisons Transhumain.
Écrit par : Samuel | 29/08/2007
Encore un et on aura toute la série, c'est bien ça ? Effectivement, tu as l'air d'avoir fait un sacré travail sur le texte, qui a dû nécessiter de multiples relectures et prises de notes, sans compter les références extérieures... J'attends le dernier pour avoir une meilleure vision d'ensemble de la chose.
A bientôt !
Écrit par : François | 29/08/2007
Détrompe-toi, François, il y a encore 5 textes, après celui-ci, et après on commencera (peut-être) à entrevoir un début de conclusion.
Le but: écrire une critique plus longue que le bouquin.
(ok, Olivier, je sors)
Écrit par : Bruno | 29/08/2007
Bruno, tu n'es, hélas, pas loin de la vérité... Non, François, c'est loin d'être terminé ! Il faut que je termine le difficile "Temps, récit et schizophrénie", puis on enchaîne sur l'idée de lien, de filiation, de chaîne, sur le sens de la mort, avant de terminer sur ce qui fait la synthèse de tout ce qu'on aura vu - l'écriture selon Colin...
En fait, la seule façon d'interpréter idéalement le livre, serait de le réécrire mot pour mot, comme dans la nouvelle de Borges...
Écrit par : Transhumain | 29/08/2007
Hé bien, quel programme ! Transhu, je vois à la dernière phrase que tu es effectivement et irrémédiablement atteint...
J'attends la suite du feuilleton de l'été indien, alors.
Amitiés.
Écrit par : François | 30/08/2007
Bon, je le lirai, bien que vous ne m'en donniez pas une si grande envie que ça. J'ai l'impression ou plutôt je crains qu'avec votre critique, qui est un beau travail j'en conviens, vous n'essayiez de vous montrer supérieur au romancier. (Il serait bon d'avoir l'avis de Colin la-dessus). On a ce sentiment que vous comblez ses vides. Plus encore on peut imaginer que vous corrigez ses clichés. Car on peut se poser la question, dans la littérature de science fictiion (ou assimilée) l'imaginaire est si travaillé ou le le récit si recherché (les premières lignes d'Artefact de Dantec paraissent parfaitement symboliques de ce que je veux dire), que l'on a le sentiment de macèrer dans un lieu commun que racheterait le clinquant futuriste.
Écrit par : Robin | 04/09/2007
Robin,
La Mémoire du vautour n'est pas à proprement parler un roman de SF : ici, pas d'attirail futuriste. Et non seulement je n'essaie pas de me montrer "supérieur" au romancier, mais encore, telle comparaison ou opposition n'a pas grand sens : si j'entends en effet prolonger l'oeuvre, la faire exister un peu plus dans la sphère de l'information, et aider quelques uns à la mieux comprendre, je n'en suis capable que si le livre, à mes yeux, le mérite. Le romancier est poète, il fait partager des visions, des intuitions : il crée un monde avec ses propres règles, qu'il s'agit dès lors d'interpréter comme de l'intérieur, par "épochè", si je puis dire, et par réduction phénoménologique.
Mais plus concrètement, l'impression que vous avez que mon texte comblerait les vides du roman, est sans doute dû au fait que, dans les premières parties, déjà mises en ligne, je ne m'attaque guère frontalement au texte lui-même. Pour l'heure, je me suis "contenté" de poser les bases de l'interprétation finale. Mais rassurez-vous : nous allons progressivement entrer au coeur du roman, avec "Temps, récit et schizophrénie" d'abord, où nous digresserons encore longuement mais en nous fondant sur de nombreux exemples, puis avec les dernières parties, consacrées au lien, à la transmission/filiation et à la grande métaphore réflexive de La Mémoire du vautour. Alors, le projet du roman, du moins tel que je l'ai envisagé, apparaîtra clairement.
Qu'on me pardonne, d'ailleurs, le retard de la parution de la sixième partie, a priori reportée à lundi.
Écrit par : Transhumain | 05/09/2007
Le probème est que votre commentaire est mieux que le livre lui-même, mieux écrit, plus réfléchi, car il faut bien dire que Colin écrit avec une truelle, phrases courtes sans relief, personnages sans épaisseur, descriptions naines, bref une écriture blanche qui, à mon avis, n'est pas effet de style, mais reflet de la pauvreté de son art, de sa technique devrais-je dire. Il y a des idées, mais cela ne suffit pas. On a l'impression de lire un scenario pour un téléfilm de 13ème rue, non un vrai livre avec ce qu'il faut de rigueur et de style, car sans style à quoi bon écrire. Les meilleurs écrivains d'anticipation possèdent avant tout un style: Lem, Ballard, Self, mais Colin connaît à peine la grammaire française, et encore moins sa prosodie.
Sinon parfait pour le site et les analyses
Écrit par : ariel | 19/09/2007
Ouuuuuuups ! Ariel, je répète cela à Olivier et (Systar) depuis quelques mois, vous risquez de les énerver...
Au fait les gars, vous êtes morts, transluminiquement parlant, ou quoi ?
N'avez-vous pas entendu dire qu'il fallait travailler plus pour gagner plus des fois ?
Écrit par : Stalker | 20/09/2007
Ce que dit ariel sur l'écriture de Colin prouve un stade de cécité pour le moins avancé. Phrases courtes? Oui, si l'on arrête la phrase au point. Personnage sans épaisseur? Eh bien, justement, ces personnages sont en quête d'une épaisseur dont ils se méfient, d'où la profondeur de leur fausse et plate virevoltante finitude. Descriptions naines? Ou nano-chirurgicales, plutôt, non? puisque Colin, souvent, charcute des bouts de paysages qu'on croyait extérieurs. Des idées? Sûrement pas. Colin n'a pas d'idées, sinon il bosserait chez Larousse ou à TF1. L'idée-Colin est juste un origami dont on a oublié la fabrique et dont on redoute le déploiement: en général, cent pages plus loin. Non, pas besoin d'idées, tout n'est que vivier technograve, se pencher suffit. Un scénario genre 13ème Rue… Ah. Alors là, je ne sais pas, je me sers de la télé comme d'un bocal. Chacun ses poissons. Faut lire de drôles de trucs pour penser ça de Colin. Ou pas lire. La prosodie, Colin la connaît, mais il fait ça discret, enlève une béquille puis l'autre, y va mollo. Il se ménage, c'est vrai. Mais sûrement pas pour durer. Il sait juste ce qu'il fait. J'oserais pas trop l'emmerder. Surtout, j'aurais pas envie de. Mais bon. Bon vent aux opinions.
Écrit par : claro | 20/09/2007
Merci, Claro (tiens, je suis en train de lire votre traduction de Dying inside de Silverberg : quelques erreurs et coquilles, mais elle est meilleure que celle d'Abadia !).
Ariel, Juan, vous vous trompez lourdement. Vous pensez ce que vous voulez, mais j'avoue certain agacement : si j'écris sur un roman, sauf exception, c'est qu'il en vaut la peine.
Mais surtout, dans La Mémoire du vautour, les phrases courtes, et en particulier les phrases nominales, ont un sens fort, qui n'aurait pas dû vous échapper. Elles (les secondes surtout) expriment à l'évidence la temporalité singulière, annulée, de ces personnages schizos. Je développerai cet aspect dans la sixième partie, encore ajournée mais en bonne voie. Pas de style, Colin ? Pour fréquenter son oeuvre depuis des années, je peux vous démontrer le contraire (encore que Bruno s'en chargera mieux que moi). Par ailleurs, mon analyse n'est pas encore terminée, loin de là : attendez donc. Après ça, je défie quiconque de me soutenir que La Mémoire n'est pas un roman au moins intéressant.
Juan : ce n'est pas en s'en tenant à Faulkner ou Bernanos, dont le génie n'est plus à démontrer, que tu vas échapper au disque d'accrétion...
Et tu diras à Francis Moury que Profondo Rosso fait EVIDEMMENT, et très volontairement, référence à Blow up.
Écrit par : Transhumain | 21/09/2007
Je persiste et je signe. Ce livre est mal écrit, mal fichu, aussi maigre littérairement parlant qu'une fiche lecture du reader's digest. C'est pauvre et indigent du point de vue de la langue, et ce en dépit de quelques idées (j'insiste la littérature est faite d'idées, pas d'idées théoriques, bien sûr, mais de concepts devenant des percepts, des situations sensorielles, comme l'idée de la métempsycose du tueur du vautour à l'homme vie le requin). L'intrigue est intéressante et la composition également, mais on n'y croit pas une seconde car il n'y a aucun élément qui permette de se raccrocher à l'histoire, faute de style. Et lorqu'il y a des envolées poétiques, elles tombent complètement à plat (ex. p. 63: "la nuit est un foulard de magicien agité par le ciel, un tour raté que personne ne remarque"). Tout le reste est à l'avenant. J'insiste: on lit un scenario agréable à lire comme tel, mais pas un livre, à savoir le récit d'une expérience. Ici se donne à voir une structure sans chair, sans vie, un truc world, branché. Exemple: dans toute la partie sur l'indonésie, on ne ressent rien, ni la pression de la jungle ni la frénésie de la vie, du grouillement de la vie (relisons Conrad!). Le plus ridicule est sans doute le dernier récit avec ce professeur mélancolique qui couche avec ses étudiantes (bonjour le cliché ou le fantasme post-pubère. Même cliché entre Narathan et sa belle-mère). Le style télégraphique qu'accentue l'usage du présent, du genre "J'entre dans la pièce, j'avise le type en manteau bleu, il me fait signe de le suivre", est rasoir à la fin, car encore une fois on n'y sent que l'urgence d'un récit qui n'arrive pas à atteindre une certaine épaisseur humaine, je parle de celle du lecteur. Je passe également sur des dialogues parfois d'une insipidité rare (p. 71: "qu'est-ce que nous sommes devenus Marcus? (sic, merci pour le français!) - C'est la guerre chérie".) qui ferait passer Gérard de Villiers pour Julien Gracq. Bon j'arrête, car je vais m'énerver. Mais un dernier mot, en lisant la chronique du Transhumain, toujours claire, intelligente et bien écrite je pensais avoir affaire à un grand livre. Je le commande sur Abebooks, et je le lis sur la plage (eh oui, j'habite près de la mer) un dimanche après-midi de septembre, et quelle déception! J'aurai dû plutôt nager quitte à me faire piquer par une méduse, mais au moins là j'aurai vraiment senti ce qu'est la douleur, la souffrance.
Écrit par : Ariel | 21/09/2007
Ariel, vous venez de prouver que vous n'avez rien compris au livre (Fabrice, inquiète-toi, nous ne sommes que deux ou trois à l'avoir compris - à notre façon, certes, mais compris tout de même...)... Je sais qu'on me reproche, pour l'heure, une surinterprétation, mais serait-ce trop demander d'attendre la fin de l'analyse, qui n'en est pour l'heure qu'à ses prémices, pour en juger ? Je ne trahis pas l'auteur, encore moins le livre : j'essaie de comprendre comment il fonctionne, j'analyse ce qu'il soulève en moi, lecteur, parce que c'est toujours en soi que la vérité du livre émerge, comme le savait Ricoeur.
Vous me parlez de la métempsychose du vautour, mais vous êtes-vous au moins demandé quel en était le sens ? Il y en a plusieurs, bien sûr, selon la perspective que vous choisissez, mais il s'agit d'une part d'exprimer l'idée de lien, allez, disons "spirituel" avec le monde - une idée quasi mystique -, l'idée de filiation, de trace, et il s'agit d'autre part (mais les deux parties sont liées) d'une métaphore (assez limpide) de l'écriture selon Colin. D'ailleurs cette métempsychose vaut pour le bouquin dans son ensemble, quoique sur un mode moins linéaire. Je le répète une énième fois : je vais développer tout ça. Vous trouvez ça sans vie, artificiel ? Normal : ce roman évoque des marionnettes, des pantins qui s'interrogent, et pour cause, sur leur réalité.
Conrad ? Quel rapport ? Vous vous trompez de références, or celles de Colin sont explicites... Pardon, mais vous me donnez l'impression de chercher dans un livre, en l'occurence celui-ci, quelque chose de précis, qui précède le texte. Je n'attendais rien de ce roman. Ma première lecture m'a même laissé un peu sceptique : mon Dieu, ça parlait de quoi ce machin ? Et puis ça m'a travaillé, des thèmes se dégageaient, une émotion aussi, et c'est ça que je mets en lumière (enfin, j'essaie).
Vous me parlez de l'emploi du présent, des phrases courtes : je vous ai déjà répondu sur ce point, il est pour moi très pertinent. Et, qui plus est, efficace. Il n'y a pas de temporalité classique, de passé, d'avenir sur lesquels fonder ses choix. La "blancheur" du style était ici essentielle. Que vous ne soyez pas sensible à ce style, je le conçois parfaitement, mais de grâce, ne vous instituez pas en pape du bon goût, sans autre argument qu'une poignée d'extraits jamais situés dans leur contexte, quand moi, je passe de nombreuses heures à dégager du texte certaine essence. Je n'écris pas une critique normative ici. Je soumets le texte à l'épreuve de l'analyse. Et, miracle, ça tient. Bien sûr, je suis ouvert aux critiques, aux contradictions. En fait, je les sollicite, mais j'aimerais que la discussion porte sur l'analyse, et non sur la prétendue nullité du livre...
Amicalement.
Écrit par : Transhumain | 21/09/2007
Bon.
1) Olivier, en matière de style, j'ai décidé d'arrêter de me faire chier. On ne satisfait personne à en parler: les auteurs et les critiques trouvent qu'on surinterprète. Reste juste une toute petite catégorie, infime, qui parfois nous dit qu'on a bien fait d'essayer d'écrire quelque chose d'un peu fouillé sur des bouquins dont la richesse et la plénitude de sens ne sont pas immédiates: ça s'appelle les lecteurs. Vous savez, gros cons qui ont lâché 29 euros pour la Horde et 20 pour le vautour.
2) Juan: je ne suis pas transluminiquement mort, je bosse pour Actu SF de temps en temps. Et je te retourne l'interrogation: entre republications et notules, je te trouve moins disert et moins passionnant qu'à certaine flamboyante époque du Stalker. De nouveaux grands articles à venir? des auteurs injustement méconnus à dépoussiérer?
3) parce que je ne suis pas rosse, et même si j'ai dit que je voulais éviter de parler de style: Colin écrit bien. Point barre.
4) c'est pas un truc world, branché. Au contraire. C'est du "tout fait signe" bien intello, un truc où il faut décrypter la valeur symbolique des animaux, du temps, des lieux, etc. Reprochez à Colin son intellectualisme, il est flagrant sur ce livre difficile d'accès, mais pas son inrockitude!
Écrit par : Bruno | 21/09/2007
Je parle style, vous répondez structure, intention, sens caché. Ok, je suis d'accord avec vous que ce livre est bourré d'intentions, et même d'inventions. Mais c'est le résultat littéraire que je juge pas le projet philosophique ou théorique. Votre analyse demeure essentiellement théorique, non stylistique. Quant aux exemples choisis, ils ne sont pas arbitraires, il y en a une centaine d'autres dans le livre du même acabit. Moi, je trouve qu'il n'écrit pas, ni bien ni mal, il n'écrit pas; il suit une trame, un scenario, c'est tout. Mais on ne ressent rien, c'est trop cérébral et en même temps pas assez intelligent. Mais il s'agit de simples impressions, cela ne remet pas en question la qualité de vos analyses, au contraire cela leur rend grâce de trouver de la qualité là où il n'y a, à mon humble avis, que de la quantité (d'intention, d'idée, de projet). L'allusion à Conrad se justifie pour la peinture de l'indonésie, de son climat oppressant, de la jungle, de la peur, etc. Tout ce qui est absent du livre de Colin. Ensuite, il ne s'agit pas de comprendre les métaphores mais de les vivre, or, je suis désolé, mais je ne ressens rien à la lecture de ce livre, je vois le travail, pas l'oeuvre, et c'est bien là le drame de la littérature contemporaine: on voit les marques de fabrique partout. Mais ce n'est pas bien grave, heureusement qu'il reste de bons livres à lire dont le souvenir persiste comme une rétention temporelle. Le dernier en date Epépé de Karinthy chez Denoël et d'ailleurs. Vrai chef d'oeuvre, atmosphère étouffante, style limpide, en accord avec son thème.
Bien à vous tout de même et merci pour le blog toujours passionnant
Écrit par : ariel | 21/09/2007
Bah, on en reparlera plus tard, Ariel. Je ne lâcherai pas l'affaire aussi facilement ! Très vite, tout de même : je ne sais pas, moi, ce que signifie "avoir du style". Chaque livre exige sa propre écriture. Kathleen, le précédent Colin, était bouleversant. Celui-ci est plus sec, plus abstrait, une image en cache une autre, et le verbe est soumis à l'univers du livre. Je soutiens, moi, que Colin écrit bien. Et que la référence à Conrad est mal choisie : à aucun moment, le roman n'essaie d'instaurer une atmosphère poisseuse, oppressante, où le mal rôderait. Il faut plutôt chercher, par exemple, du côté du film Tropical Malady, cité dans le roman, où il est question d'un homme qui devient tigre, et où la jungle est le décor d'un conte métaphysique. La jungle de La Mémoire du vautour, les rues de Medan, sont bien des décors, à l'image de la ville dans Millenium People de Ballard. Le trip du roman n'est pas géographique mais intérieur. Pas de Mal qui rôde, seulement des signes à interpréter.
Dernière chose : non, l'intention de Colin ne m'intéresse pas dans cette analyse. Peu m'importe que l'auteur ait voulu ou non insuffler du sens partout : l'important est que je discerne des motifs cohérents, une structure qui, pour une raison ou pour une autre, sont entrés en contact avec moi. Et j'ose espérer que d'autres que moi seront sensibles aux aspects du roman que je tente de mettre en lumière...
Epépé ? Pas lu hélas : j'ai longtemps hésité à l'acheter, et puis, non, trop fauché. Je le réinscris sur mes (déjà longues) tablettes...
A bientôt.
Écrit par : Transhumain | 21/09/2007
Merci, Bruno, au fait. De toute façon, je m'en fous. Qui parle de La Mémoire du vautour depuis sa sortie ? Personne, ou alors, pour dire qu'on n'y a compris que dalle. Deux ou trois blogs, à tout casser, l'ont évoqué (dont celui de Claro). Et les revues et sites de SF n'ont rien panné. Donc, je fais EXISTER le livre, durablement, sur la Toile, en lui accordant mon temps et mon attention, parce qu'il m'a paru le mériter, parce qu'il m'a résisté, parce qu'il a suscité ma curiosité. Certains ont acheté le bouquin, grâce à moi (ou par ma faute, cf. Ariel : sincèrement désolé de vous avoir fait perdre 20 euros !), et pas seulement parce que j'aurais lancé "un livre génial à lire absolument !". J'ai la modestie de coire que mon opinion ne vaut rien. En revanche, le boulot, il est réel, il est là, et apparemment, il intéresse quelques uns (y compris ceux qui n'ont pas aimé le livre !). Et, entre nous, Fabrice Colin est un des rares auteurs, du moins dans la sphère des littératures dites d'imaginaire, à être conscient de ça. Enfin, il me semble.
Bon, faut que je bosse la suite. Profitons-en : j'ai la patate.
Écrit par : Transhumain | 21/09/2007
En vrac les amis, donc dans le désordre, pardon.
1) Transhu, tu as bien raison de penser que ton avis critique a quelque valeur, et c'est bien là qu'est le problème : je ne compte plus les livres achetés grâce ou à cause de toi et que je n'ai pas encore lus, loin de là. Du moins m'étais-je livré à une lecture de la Certaine idée de l'Europe de Steiner, qui ne valait rien contrairement à ce qu'affirmait ton article...
Un petit jeune m'a envoyé un texte sur Deleuze lu par Damasio, tu m'en diras des nouvelles.
Je vais vous le dire : Bruno et toi, vous savez lire, indéniablement mais vous êtes des philosophes (de formation ou de tête : vous avez la tête philosophique) et tireriez une thèse d'un texte écrit sur une seule feuille de papier-cul. Je ne dirai pas que je suis uniquement littéraire (ce qui a le don d'emmerder les intellos ou prétendus tels) mais enfin, lorsque je n'ai rien à dire sur un livre, je n'en dis rien... C'est peut-être pour cela que, ces derniers temps, non messieurs, aucune nouveauté ne m'a donné l'envie, la rage d'écrire... Pourquoi ne pas l'avouer ?
Encore : je te tire mon chapeau sur un point en revanche, Olivier : tes efforts, remarquables, pour défendre les livres que tu aimes...
2) Du coup, contrairement à tes dires cher Olivier, je lis, je lis beaucoup, et pas que du Bernanos-Conrad-Faulkner, mauvaise langue. Je lis du Gass, du DeLillo et même du Vollmann et je vous le dis comme je le pense, cela ne vaut pas grand-chose, pas même, surtout pas les efforts de Claro pour les traduire. Gass mis à part, enfin, certaines parties de son pavé de 800 pages... Ce qui me fait me retourner vers mes chers auteurs parce que, Transhu, contrairement à l'ânerie qui t'a échappé, c'est justement en relisant sans cesse les mêmes auteurs, pourvu qu'on puisse les creuser, que je finirai bien par tomber dans le trou noir... Comme si tu ne le savais pas du reste, voyons...!
3) Et puis, eh, oh, merci pour vos recommandations mais franchement, je ne voudrais pas devenir désagréable, hein, je continue mon rythme acharné sur Stalker et, Bruno, si tu faisais un peu attention à ce que tu lis puis dis, tu constaterais que mes textes, même les plus anodins en apparence, disent toujours quelque chose sur la littérature, ce qui n'est pas le cas lorsque l'on parle du dernier super panier à 50 points de telle star de ton sport préféré. Du reste, j'ai bien ri en constatant que tu avais fini par opérer la difficile séparation de tes passions : deux blogs, enfin !
4) Bruno, tes derniers textes sont inutiles, bons comme toujours mais inutiles, surtout les 30 pages écrites sur le dernier avatar de la série Dune, nullité commerciale absolue s'il en est. Surinterprétation donc mais je crois que ce n'est pas la première fois qu'on vous le dit.
Mais je vous aime toujours, n'allez pas vous fâcher.
Écrit par : Stalker | 21/09/2007
Ah oui : et j'attends, la Terre entière avec moi, vos notes respectives sur Artefact.
Vous allez me ruiner.
Écrit par : Stalker | 21/09/2007
Au fond, tu as peut-être raison de dire que tu es plutôt "littéraire" et nous "philosophes". Je dis "peut-être", parce qu'étant justement étudiant dans ladite discipline, je ne sais pas ce que c'est qu'être "philosophe".
Je n'y peux rien, j'aime toujours autant cette pirouette: je NE SAIS PAS ce que c'est que LA philosophie, L'OCCIDENT, LE CHRISTIANISME, LE MAL... Et plus je tente de les étudier, moins je les comprends et les connais...
Que tu dises toujours quelque chose sur la littérature, j'en conviens. Que ce soit, à chaque notule, radicalement nouveau, voilà sur quoi j'émets des doutes. Mais rien de grave, hein... Faut bien vivre un peu, à côté!
Pour Artefact: je viens de dire ce que j'en pensais rapidement sur Systar, je ferai un papier pour Actu SF, et un truc de "philosophe" sur la petite novella "Artefact", qui n'est pas vraiment de la littérature, mais une sorte de philo narrative, ou un truc comme ça. Ne lis pas les autres novellas (sauf peut-être la première, quelques petites choses pas mal, dedans), par contre, ça risque de ne pas te plaire. Et puis je ne sais pas qui a édité ce livre, mais c'est corrigé et édité à la truelle.
Franchement, pourquoi te répands-tu sur Dantec, alors que ce n'est pas après lui, après sa personne, que tu en as? Tu es infernal, intenable... savoureux, du coup, mais un rien hargneux!
Le basket: oui, finalement, j'en ai fait mon deuil... surtout depuis qu'on a fini 8èmes à l'Euro, comme tu n'as pas manqué de le remarquer, je suppose...
Écrit par : Bruno | 21/09/2007
Oui, et tu as remarqué que, plein de mansuétude pour ton probable chagrin, je ne me suis même pas moqué.
Je me répands sur Dantec ? Merde alors, tu te (celui qu'il ne faut pas nommer)ise à grande vitesse on dirait ! Des preuves mon vieux, des preuves parce que, sauf erreur de ma part, hormis le fait de dire que je ne lirai pas le petit dernier, là, non, je ne vois pas (ah oui, trois lignes sur un de mes anciens posts concernant la non-rentrée littéraire)... Et tu te trompes aussi sur le fait que ce n'est pas à lui que j'en veux : à son niveau, au niveau de n'importe quel gamin de troisième du reste, nul n'a le droit de lui dire qui est ou pas son ami, je me trompe ? A moins que Dantec ait besoin qu'on fasse le vide autour de lui et démoralise les meilleures intentions, alors là, c'est bien parti pour...
Dans trois posts, tu vas voir, tu vas me donner du Judas toi aussi !
Dernière chose : c'est un gage de qualité, de dire quelque chose de toujours nouveau, surtout sur un blog ? Ton argument (ou apparenté) est franchement con, pardon de te le dire. Il me semblait au contraire que n'importe quel auteur un peu conséquent ne faisait jamais qu'approfondir les mêmes thèmes, non ?
Parce que tu crois que je sais ce qu'est le Mal par exemple ? Tu devrais lire ma Littérature à contre-nuit dans ce cas : tu y verrais que j'adopte plusieurs angles d'attaque pour tenter de cerner un vilaine bête qui ne se laisse jamais capturer.
Tu serais pas un peu fatigué dès fois, Bruno ? Tu réfléchis davantage d'habitude, non ?
Écrit par : Stalker | 21/09/2007
Stop, la Terre a dû s'arrêter de tourner pendant au moins une seconde.
Je viens de m'apercevoir qu'Assouline a fait un lien sur son site vers mon texte sur Le Maître du haut château les gars !
Je n'en reviens pas et, positivement choqué, vais demander de ce pas l'aide d'une cellule psychologique comme disent les médias.
Ca y est, Bruno, t'as affiné tes arguments ?
Écrit par : Stalker | 21/09/2007
Là, tu cernais quoi, exactement?
http://stalker.hautetfort.com/archive/2007/09/10/the-racing-rats.html
Que la nouveauté ne soit pas forcément le gage d'une réflexion de qualité: j'en conviens. Mais une pensée peut être complétée, adopter de nouvelles méthodes, se tester... Enfin, j'dis ça, j'dis rien. et c'est très vrai que je n'ai pas lu ton livre. J'irai lire tes posts les plus récents, alors, je verrai si c'est moi qui suis la fameuse loi du transsystar-surestimeur: plus tu surestimes de mauvais livres, moins tu sais reconnaître la vraie pensée et la vraie littérature quand elle apparaît...
Dantec: non, tu ne te répands pas, mais tu nous as fait tes "adieux à Dantec", annoncé que tu ne le lirais pas... Remarque, vu ce que tu avais dit sur Grande Jonction, il valait peut-être mieux que tu t'abstiennes pour celui-là.
Écrit par : Bruno | 21/09/2007
Voyons cher Bruno, tu lis mal à ce point ou ce sont les bêtises de SF qui te tiennent effectivement loin d'un certain bon sens ? Je ne sais pas moi, un réseau (mot que tu aimes) de correspondances entre : les hommes creux, la fuite de l'instant, un amour perdu, la quête de la Reprise kierkegaardienne, l'allusion à un événement imminent sur le mode du rêve, etc.
Comme si tu ne savais pas qu'un texte littéraire se nourrit de style (tu es un spécialiste, tu dois savoir de quoi il s'agit) et est ridiculement chosifié dès qu'on en donne ainsi, comme je viens de le faire, quelques rapides clés de lecture.
Effectivement, sur Grande Jonction, je n'ai pas dit grand-chose parce que je n'avais rien à dire et que je conservai encore mon affection à Dantec, d'où ma gêne. De toute façon, hormis à en écrire mille pages inutiles (bel exercice intellectuel, c'est tout, meilleur que le livre) et brillantes, je n'ai pas eu l'impression d'être passé à côté d'un livre exceptionnel, si ?
Et puis tu lis mal à la fin : en bon observateur, tu aurais dû remarquer que cette raréfaction se faisait sentir dès Cosmos Inc, pour lequel, à mon goût, j'en ai trop dit, et encore, je reste tout de même dans certaines limites.
J'ai d'ailleurs peur de ton annonce concernant une des nouvelles composant Artefact... Nous verrons ce que tu fais de ton motif tri-dimensionnel inspiré de la plus ancienne patristique. N'oublie que c'est un roman, pas un trait d'Irénée de Lyon; s'il n'y a pas de plaisir de lecture mais seulement celui de nous écrire un joli petit texte bien ficelé, alors ne barguigne donc pas : Dantec a loupé son coche, c'est tout.
Maintenant, sois certain que je n'éprouve, envers Dantec, plus ce genre de... frein. Encore faudrait-il que je lise Artefact et, pour cela, j'attends, je vous l'ai dit, vos lumières respectives, à toi et à Olivier.
PS : dans mes posts (je préfère textes) les plus récents, Synesthésies devrait te plaire, enfin je crois.
Écrit par : Stalker | 22/09/2007
Un traité, encore que trait ne soit finalement pas si mal...
Écrit par : Stalker | 22/09/2007
Ahhhh ! Il suffit que je m’absente quelques heures, et la zone de commentaires devient le temple de la camaraderie virile !
Juan : je ne me fâche plus, désormais. J’ai le sang encore plus froid que maître Yoda. Empathie déficiente. Je dois être atteint du syndrome d’Asperger… Moi, philosophe ? Tu insultes les vrais philosophes, là ! Moi, je ne suis que le Transhumain, le Connor MacLeod de la critique. Assiégé de toutes parts, mais invincible.
Bon, un peu de sérieux. Je sais que tu lis beaucoup. Et je n’ai pas encore lu Gass, ni les derniers Vollmann. Mais je ne peux pas m’empêcher de penser que si tu rejettes l’intégralité, ou presque, de la littérature contemporaine, c’est que tu y cherches quelque chose de précis, que tu ne trouves pas. Je n’ai malheureusement pas le temps de lire autant que je le voudrais, sans compter que je suis un lecteur très lent, mais bon sang, avec des auteurs comme Pynchon, Ellis (dont je viens de commencer Lunar Park, pas très bien traduit, j’ai l’impression, mais, pour le moment, excellent), Palahniuk, DeLillo, Vollmann (mais je n’en ai lu que deux), et même Egan, Damasio, Colin, Danielewski, Ballard (même s’il déçoit ces derniers temps) et j’en passe, avec ces auteurs donc, nous avons encore de quoi nous torturer un max. Alors oui, bien sûr, il faut relire, et je relis (Beckett, Kafka, Tolkien, Dick, Silverberg…) mais le temps manque souvent.
Sur la surestimation maintenant. Le Steiner, ça commence à dater… C’est vrai que c’était un petit bouquin de rien du tout, mais j’y avais trouvé de quoi alimenter ma réflexion (et puis en période électorale – c’était avant le référendum sur la constitution européenne –, mon jugement critique s’efface un peu !). Pour le reste, je ne crois pas avoir perdu mon temps sur un livre qui n’en valait pas la peine. Mon blog ne reflète pas vraiment mes lectures : promis, j’écrirai un jour sur Beckett (bientôt, même, mais en trichant, à propos de son Film), sur Kafka, sur Dick, sur Pynchon, sur Melville, Ballard, Ellis, Tolkien ou Conrad. Parfois mes textes expriment mes déceptions, mais toujours pour des livres hors du commun, singuliers (cf. Beauverger, Bénier-Bürckel, Dantec…).
Sur la « nouveauté » nécessaire : j’ai quand même l’impression que tu tournes un peu en rond, depuis déjà un certain temps. D’où ma remarque sur le trou noir. Attention avec les trous noirs. Peut-être sont-ils des créateurs d’univers, comme le suggère Stephen Baxter dans Temps, mais quand on y tombe, c’est pour de bon (tiens, et si tu écrivais un peu plus sur la science-fiction ?). Pas de surestimation chez toi (quoique : http://stalker.hautetfort.com/archive/2007/08/21/parution.html ! ;-)). En revanche, une tendance compulsive à taper sur des auteurs qui n’en valent pas le coup. Millet, on s’en fout. Les diafoirus on s’en fout. Et puis tendance aussi à sous-estimer des auteurs qui ont une authentique voix (Colin, donc). Mais nul n’est parfait, hein !
Le Dantec : pas encore lu, mais ça ne saurait tarder. En vérité, je crains le pire… Comme je l’expliquais dans mon article des Infréquentables, et comme tu le rappelles ici, l’horizon s’étrécit depuis au moins Cosmos Inc., livre ambitieux mais dont l’échec, même partiel, était patent. Formellement, Artefact a l’air encore plus poussif que Grande Jonction. Anaphores à tous les étages.
Allez, bon week-end les amis.
Écrit par : Transhumain | 22/09/2007
Eh bien, on va finir comme deux immortels et, mon ami, tu sais qu'il ne peut en rester qu'un !
Bien sûr que je tourne en rond : personnellement, je cherche mes mots, ce que je n'ai jamais vraiment caché je crois. Je nourris de plus en plus de doutes (vieille antienne) à l'égard de l'expérience que constitue Stalker, ce qui me différencie assez nettement d'un Autié, très enthousiaste vis-à-vis de tous ces nouveaux supports. Et pourtant, Dieu sait que je ne suis pas hostile au Réseau. En mars 2008, Stalker sera vieux de quatre années bordel, ce n'est pas rien...!
Ajoute à cela un dégoût à peu près total de ce qui s'écrit actuellement et, non mon vieux, Millet n'est pas uniquement un cacographe, c'est plus complexe que cela : lis son Désenchantement de la littérature, assez beau.
Millet n'est mauvais que lorsqu'il s'entoure d'imbéciles heureux, comme c'était le cas pour Harcèlement littéraire.
Qui plus est, sa position est intenable : on ne peut se vouloir le dernier écrivain tout en ayant sa place chez Gallimard, non ? J'y reviendrai sans doute dans une prochaine note.
Du coup, l'humeur est à la mélancolie, voire pire, beaucoup plus noir, ce que je dis dans certaines de mes notes, celles-là même que notre petit robot gavé de philo (je te charrie, hein !) et qui écrit de la copie à la demande, j'ai nommé Systar, n'aime pas.
On ne s'en fout pas des Diafoirus et puis, je ne sous-estime personne, pas Colin ni Damasio, que je n'ai pas lus.
Je surestime ? Non : Vajda a écrit un ou deux bons livres et, regarde, dès que par malheur j'ai dit que Contamination était un joli clip pour pré-ado nourri de Joy Division, elle ne m'a plus adressé un seul mot, attendant bien sûr, tout de même, que paraisse son texte sur les Infréquentables. Qu'elle aille donc se faire foutre, puisque désormais son agent littéraire est qui tu sais.
Revenir à la SF ?
Mais je ne l'ai jamais quittée !
Non, je reviens à de vrais auteurs mon vieux, tous ceux qui résistent quand s'épuise notre fascination d'un jour pour les petits jeux littéraires chers à DeLillo, Vollmann et même Gass, quoi que ce dernier soit au-dessus des deux autres.
Mais ces petits jeux ne valent pas un vrai roman, un de l'immense McCarthy par exemple, le ténébreux Méridien de sang ou le bouleversant Suttree.
Tu vois donc que, comme toi, e n'hésite jamais à clamer mon enthousiasme lorsque je tombe sur un bon livre et, oui, contre Millet, il y en a encore même si son constat de fonc est absolument juste.
See you.
Écrit par : Stalker | 22/09/2007
J'ai lu cette nuit ton texte Synesthésies: effectivement, c'est intéressant... On va dire que cela constituera une belle entrée en matière à mon travail de préparation d'agrégation puisque cette année le thème d'étude est "l'image"...
Écrit par : Bruno | 23/09/2007
Hello tout le monde !
Bon, faites pas attention à moi, je fais que passer, et puis vu que je suis mauvais lecteur (j'affectionne particulièrement la Horde et j'ai lâché du blé pour le dernier Colin. Ah ! Heureux temps où j'avais de l'argent pour m'offrir des conneries), mon avis compte pour du beurre (vu mes origines, hein. Ou sinon, j'aime bien celle-là : "mon avis compte pour de l'huile d'arachide... de Rachid... non ?). Bon désolé de rabaisser le niveau, mais je tenais quand même à dire que j'ai lu deux fois la Mémoire du vautour et quelque fois même, il m'arrive de relire certains passages. J'apprécie d'autant plus le début d"analyse du Transhumain dont j'attends la suite avec impatience. J'aime ce genre de livre qui me résiste et que, une fois celui-ci fermé, je me dise "j'ai pas tout compris, pas parce que le bouquin est bidon, mais bien parce que moi je manque de discernement." En même temps, je dame le pion à ceux qui seraient tenter de le faire, hein, mais je le répète, je suis un mauvais lecteur et je ne lis que de mauvais romans.
Tiens d'ailleurs, niveau lecture, à moins que je ne les précède, je suis souvent les conseils de vos blogs, hein, Olivier et Bruno. J'en conclue donc, mes chers que vous êtes mauvais.
Cordialement, quand même.
Chekib.
Écrit par : Aïn | 23/09/2007
La preuve que tu es un mauvais lecteur: tu as lu des Clubs Van Helsing. Et ça, c'est mal, Chékib...
Écrit par : Bruno | 23/09/2007
Mouahahhaah ! C'est méchant ça de ta part !
De toute façon, sur ce coup là, je n'ai fait que te précéder.
Je suis sûr qu'Olivier en a lu mais qu'il n'ose pas le dire. C'est le genre de truc qu'on préfère cacher.
Écrit par : Aïn | 24/09/2007
Eh bien non, Chekib, pas lu le moindre CVH pour le moment. Pas le temps, pas envie.
Pour ton porte-monnaie : tu as tout de même du bol que je sois si lent à mettre le blog à jour... En plus, là, je passe deux mois sur le même bouquin. Tu vois : je te fais faire des économies.
Écrit par : Transhumain | 24/09/2007
(Putain, j'ai vraiment visité tout les blogs de la blogosphère)
Aurais-je le droit de rajouter moi-même un commentaire débile qu'on donne souvent dans les skyblogs? Oui? Non? Bon:
J'adore ce blog, comme celui du Stalker, comme celui du Systar, comme celui du Montalte. Je vous lis énormément tout les trois depuis peu, vous êtes comme des gardiens de la Sainte Bibliothèque, celle qui abrite en son sein seulement des bons livres, et non pas des torchons comme j'en étais habitué à lire il y a fort longtemps.
Bon, ben, j'avais besoin de le dire, c'est tout.
Cordialement,
Skutanea
Écrit par : Skutanea | 24/09/2007
Bon, ok Skutanea. Maintenant, la vraie question, c'est: qui tu préfères, entre ces différents blogs que tu apprécies??? et pourquoi?
Te sens-tu "dangereux transhumaniste", "vivisecteur du corps grouillant de la littérature", "chestertonien joyeux", ou mioche philosophe en crise existentielle permanente?
En tout cas, merci, et continue à cliquer, ça nous flatte... ;-)
Écrit par : Bruno | 28/09/2007
En d'autres termes : es-tu plutôt 1) schizo 2) parano 3) sadomaso 4) philo ? 5) ne se prononce pô ?
Écrit par : Transhumain | 29/09/2007
Disons que j'apprécie autant Deleuze que Chesterton, Hello, que...quel serait votre "philosophe préféré", Monsieur Systar, alors?
Écrit par : Skutanea | 29/09/2007
Rosenzweig, of course!
Écrit par : Bruno | 29/09/2007
Malheureusement, pas encore lu.
Écrit par : Skutanea | 29/09/2007
Alors dès que tu as un mois devant toi, tu te mets au vert et tu attaques L'Etoile de la Rédemption...
Écrit par : Bruno | 29/09/2007
Encore faut-il trouver le bouquin... Car ce philosophe n'a pas l'air - au vu de mes documentations - très connu. Peut être que l'unique grand "dossier" consacré à lui est le votre d'ailleurs.
Écrit par : Skutanea | 29/09/2007
(Skutanea, on se tutoie, n'est-ce pas? on est sur les blogs...)
Tu peux le trouver sans problème en librairie de philo: sur Paris chez Vrin place de la Sorbonne ou à Gibert sur Saint-Michel, par exemple. La Procure doit l'avoir, aussi, je pense.
Sinon tu peux le commander, c'est édité au Seuil:
http://www.amazon.fr/LEtoile-r%C3%A9demption-Franz-Rosenzweig/dp/2020578697/ref=sr_1_1/171-0775764-7875412?ie=UTF8&s=books&qid=1191154231&sr=1-1
En fait il est connu des philosophes germanistes, et bien sûr de la communauté juive, même s'il n'a incarné ni la tendance mystique, ni la tendance politique sioniste dans le judaïsme, mais une voie bien particulière, qu'on peut appeler, grosso modo, "existentielle".
Il y a eu des choses d'écrites sur lui, si ça t'intéresse:
- le grand livre de commentaire: Système et révélation, par Stéphane Mosès
- L'ange de l'Histoire, par Stéphane Mosès
- les livres de Gérard Bensussan
- Témoins du futur, de Pierre Bouretz
- Courtine et Assoun se sont chargés d'éditer des traductions des autres textes de Rosenzweig, chez Vrin et aux PUF.
Et puis il y a un "Cahier de la nuit surveillée", il y a eu un colloque il y a dix ans, repris dans "La pensée de Franz Rosenzweig", Arno Münster (dir.)...
Bref: si tu veux le lire, tu peux!
Amitiés
Bruno
Écrit par : Bruno | 30/09/2007
Bah je sais pas si on peut vraiment se tutoyer, en vérité, vous êtes pour moi (avec le Transhumain, Montalte et Stalker) ce que une pseudo-chanteuse blondasse est pour une adolescente décérébrée - si vous voyez la comparaison...
C'est très bien tout cela, mais pour un humble habitant enfermé, pas pour longtemps, heureusement, mais pour l'instant, en Suisse, comment fait-on?
Merci pour les liens et les autres informations, on sent l'ardeur passionée que vous avez pour ce penseur ;)
Cordialement,
Skutanea.
Écrit par : Skuteanea | 30/09/2007
Skutanea veut donc avoir une relation sexuelle avec au moins l'un des quatre ;)
Écrit par : Aïn | 30/09/2007
"(...) Et tu diras à Francis Moury que Profondo Rosso fait EVIDEMMENT, et très volontairement, référence à Blow up. (...)
Cher Olivier,
Merci d'avoir lu mon texte sur le Michelangelo Antonioni et de prendre la peine d'y revenir.
Je suis tout près à admettre ce que vous me dites puisque j'en ai émis l'hypothèse : je serais ravi d'en avoir confirmation.
Mais en matière d'histoire du cinéma comme en matière d'histoire de la littérature ou de la philosophie, je suis méthodique : un fait est un fait, une hypothèse est une hypothèse : "non confudenda sunt" comme dirait, d'une manière que j'adapte ici un peu, le médecin joué par Richard Crenna dans le si beau et méconnu LEVIATHAN (U.S.A.-Ital. 1988) de G.P. Cosmatos.
Pourriez-vous donc avoir l'obligeance de me citer la source orale, écrite, filmique (un entretien avec Argento édité chez qui, datant de quand ?) qui vous permet de confirmer cette proposition, et du même coup de transformer ce qui était une simple hypothèse de ma part en fait avéré ?
FM
Écrit par : francis moury | 01/10/2007
erratum : le film cité supra de G.P. Cosmatos date de 1990.
Écrit par : francis moury | 01/10/2007
Merci de ta visite, Francisz. Faut retrouver ça, si ça existe. Cela dit, l'intrigue de Profondo Rosso a trop de similitudes avec celle de Blow Up, que l'emploi de David Hemmings ne saurait être due au hasard. Pour moi, c'est donc une évidence. Pour toi aussi d'ailleurs. Je te cite : "Inutile de dire qu’Argento se souviendra de Blow Up lorsqu’il reprendra Hemmings pour Profondo Rosso [Les frissons de l’angoisse] (Ital. 1976) que l’on peut considérer comme un hommage thématique, sinon plastique." En fait je ne vois pas comment on pourrait considérer que Profondo Rosso ne serait pas sinon un hommage, du moins une référence à Blow Up !
Écrit par : Transhumain | 02/10/2007
Skuteanea: très heureux d'être ta/votre Britney Spears, les bourrelets en moins.
Faut pas idolâtrer les gens comme ça, hein. Parce que Transhu, Stalker, Montalte et moi, en vrai, c'est pas franchement impressionnant... Tout juste exotique.
Par Amazon, ça doit être possible de chopper les livres, non?
Écrit par : Bruno | 02/10/2007
Pas impressionnants, ça dépend pour qui...
Écrit par : Transhumain | 02/10/2007
J'avoue que la comparaison n'était peut-être pas bonne. ^^
Bah, ce n'est pas Nietzsche (dans ce blog très apprécié) qui vous démentira: Le génie est toujours beau. Et personnellement, dans les "grands de ce monde", je ne crois pas en connaître un qui soit "désagréable à voir",de Flaubert à Turner (non, pas Tina, Joseph, le peintre) en passant par Constant, Vian...et Nietzsche aussi.
Au fait, je suis un homme, mais ne vous affolez pas (lol), je disais juste que je vous admirais pour vos écrits.
Cordialement,
Skutanea
PS: Oui, sur Amazon c'est tout à fait possible je crois, je trouverais donc quand je pourrais.
Écrit par : Skutanea | 03/10/2007
Vous ne trouvez pas Sartre beau, tout de même !
Écrit par : Transhumain | 03/10/2007
Il a son style, et on dit qu'il était bon vivant.
Je ne parle pas de la beauté dans le sens qu'on le confère actuellement, mais d'une beauté beaucoup plus mystique: Je pense qu'on arrive facilement à percevoir, en voyant Flaubert, qu'il est différent - on voit qu'il était un grand écrivain, on voit son oeuvre à travers sa chaire.
Mais la, bon, c'est peut-être de la "mystique" de comptoire, mais enfin bon. ^^
Écrit par : Skutanea | 03/10/2007
sa chair, pardon
Écrit par : Skutanea | 03/10/2007
Cher Olivier
Oui nous sommes bien d'accord : tous les deux, nous pensons que c'est une évidence, de plusieurs points de vue. Mais est-elle fondée sur autre chose que des synesthésies, des parallélismes esthétiques établis avec 30 ans de recul ? Je pensais que ton assurance prouvait que tu savais qu'elle l'était. Tu as la belle honnêteté de me détromper sur ce point.
La présence de "rosso" dans le titre DESERTO ROSSO du même Antonioni ne signifie pas pour autant que PROFONDO ROSSO lui fait référence. La présence de Hemmings n'en est peut-être pas une non plus. Qui sait ? En 1976, pour autant que je me souvienne, absolument personne n'a songé à établir le rapprochement. Sous réserve de la relecture des critiques d'époque, notamment celle de la revue Ecran.
Cela dit, aujourd'hui, nous le pensons et je pense que nous avons raison de le penser mais... cela demeure tout de même une évidence "de raison" à laquelle je voudrais trouver un appui plus tangible : propos d'Argento, de Hemmings, que sais-je ?
À creuser... sous les apparences d'un hommage, on trouvera peut-être la réalité d'un hommage. Le thème est argentien en diable, non ?
Bien à toi
Écrit par : francis moury | 05/10/2007
Il y a tout de même un rapport assez étroit entre la réalité enfouie dans les agrandissements photographiques de Thomas/David Hemmings dans Blow up - le grain brouille la vision -, et celle enfouie dans la mémoire de Marcus/David Hemmings dans Profondo Rosso - un reflet dans un miroir se mue en tableau. La plupart des films d'Argento sont influencés, me semble-t-il, par Blow up, dès L'Oiseau au plumage de cristal.
La critique de l'époque ? Il faut tout de même se souvenir qu'en 76, Argento était encore considéré comme un réalisateur de films ignobles, tapageurs, insupportablement mauvais et/ou immoraux... Alors y voir une variation autour d'un film d'Antonioni était improbable ! Cela dit, peut-être quelqu'un avait-il fait le rapprochement.
Le rapport entre Profondo Rosso et Deserto Rosso, en revanche, est beaucoup moins évident.
Écrit par : Transhumain | 05/10/2007
Oui c'est assurément un cinéaste qui, tout comme Antonioni, s'intéresse à la qualité ontologique de l'image. J'aurai dû - clin d'oeil à Eric M-G qui me disait que l'image était au programme de l'agrégation de philosophie qu'il prépare cette année - ajouter les grands films d'Argento, et au moins PROFONDO ROSSO, à ma filmographie très succincte et légère établie dans un courriel.
Bon cela dit, en guise de conclusion esthétique et philosophique. Dès que je trouve un élément historique assuré - c'est un bel exercice d'histoire du cinéma rendu aujourd'hui beaucoup plus simple par l'existence d'éditions collector américaines et européennes... que je n'ai pas dans ma Dvdthèque ! - j'en ferai part ici.
Bien à toi derechef
Écrit par : francis moury | 11/10/2007